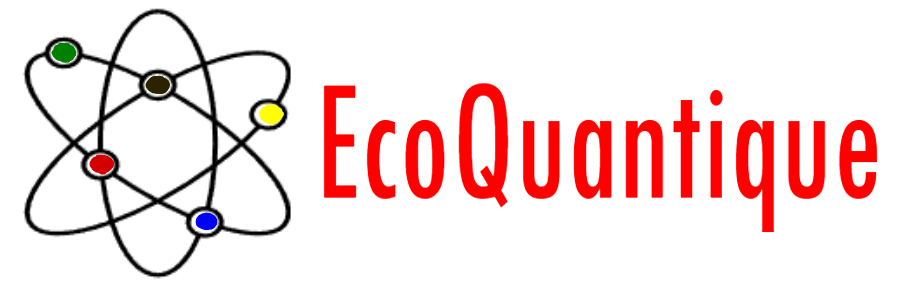Introduction
Le monde économique, politique et médiatique qui nous entoure se présente souvent à nous comme une évidence, comme l’image du monde réel, un paysage structuré par des indicateurs chiffrés, des lois et des institutions que l’on suppose être le miroir fidèle de la réalité. Taux de croissance économique, indices boursiers, sondages d’opinion, rapports de force politiques : autant de baromètres auxquels nous nous référons pour évaluer l’état du monde.
Mais ces baromètres sont-ils de véritables reflets du réel, ou ne sont-ils que des illusions rassurantes, nous aveuglant sur la condition humaine et la désagrégation du socle de valeurs qui assurait la cohésion sociale ? Plus grave encore, ne masquent-ils pas l’urgence planétaire qui s’impose à nous ?
Ou bien ces baromètres sont-ils les seuls outils dont nous disposons pour structurer la marche du monde ? Faut-il en conclure que tout est sous contrôle, que tout va bien, et que nous n’avons pas à nous soucier de l’héritage que nous laisserons aux générations futures, qui devront à leur tour apprendre à manier ces mêmes instruments pour maintenir en mouvement la grande machine-monde ?
Ici, je vous invite à une réflexion profonde et multidimensionnelle, holistique (multidisciplinaire). Elle interpelle à la fois nos connaissances en économie, mais également sur les structures politiques, nos conceptions philosophiques du réel et du pouvoir, ainsi que notre compréhension sociologique de l’organisation collective. En somme, il s’agit d’examiner si les indicateurs économiques et politiques qui dominent le discours public sont des révélateurs fidèles de la réalité commune, ou bien s’ils ne font qu’en refléter une portion tronquée au profit d’une minorité, tout en ayant des conséquences bien réelles sur l’ensemble de la population mondiale.
- Vaste programme, n’est-ce pas ?
Cette analyse propose d’aborder la question sous plusieurs angles complémentaires. Nous examinerons d’abord comment l’ordre économique et politique contemporain s’est structuré autour de mesures quantitatives telles que la rentabilité, la croissance, la puissance étatique et la propriété privée, considérées comme des indicateurs de la santé de nos sociétés. Nous interrogerons la pertinence de ces métriques : que mesurent-elles réellement ? Et surtout, que dissimulent-elles ? Sont-elles devenues une forme de fétichisme intellectuel ?
Je pose donc la question : ces indicateurs sont-ils à ce point intellectuellement confortables qu’ils nous conduisent à confondre la carte et le territoire, l’indice et le réel, au risque de nous y fier aveuglément ?
Ensuite, une perspective philosophique et introspective permettra de questionner la relation entre ces signaux quantifiables et la notion de réalité. La philosophie – à l’instar des réflexions de Pascal dans ses Pensées – nous invite à un examen de conscience collectif : en quoi notre fascination pour les chiffres et le pouvoir reflète-t-elle ou éclipse-t-elle notre condition humaine ? Sommes-nous victimes d’une illusion consentie, où l’essentiel est invisibilisé par le culte de ce qui se mesure et s’affiche ?
Parallèlement, l’approche sociologique nous aidera à comprendre comment ces indicateurs économiques et politiques influencent les comportements, structurent la société et façonnent même notre perception du réel. Si seules comptent la rentabilité et la croissance chiffrée, comment concevons-nous la valeur d’une vie humaine, d’une communauté ou d’un écosystème ?
Enfin, dans un élan prospectif, nous explorerons comment l’intelligence humaine pourrait développer de nouveaux indices pour évaluer l’état du réel commun et la maturité de l’espèce humaine. Existe-t-il d’autres baromètres, plus englobants et plus justes, pour jauger la santé globale de notre monde, au-delà des profits économiques et des rapports de force immédiats ?
Cette recherche de nouveaux indicateurs nous mènera à interroger également la notion d’intelligence elle-même. Nos inventions technologiques, de l’outil de pierre à l’intelligence artificielle, sont-elles le reflet de notre intelligence collective, ou ne sont-elles que le fruit d’un instinct d’adaptation dénué de sagesse véritable ? D’ailleurs, depuis combien de temps n’avons-nous pas entendu ce mot dans la bouche de nos soi-disant élites : sagesse ?
Dans cette analyse approfondie, rigoureuse mais accessible, nous convoquerons à la fois l’économie, la politique, la philosophie et la sociologie. Le propos se veut à la fois académique et intelligible par le plus grand nombre, en évitant autant que possible le recours aux références historiques trop éloignées du lecteur contemporain. Des arguments détaillés seront développés pour éclairer chaque aspect du problème, sans sacrifier l’esprit critique ni la profondeur réflexive nécessaire à un tel sujet.
L’objectif n’est pas de délivrer un verdict simpliste, mais d’ouvrir un cheminement intellectuel : comprendre dans quelle mesure ce que nous appelons « réalité économique et politique » est une construction partielle, et comment nous pourrions enrichir notre appréhension du réel pour qu’elle reflète davantage les expériences et le bien-être du plus grand nombre. Au fil de cette démarche, nous croiserons également la vision d’un observateur contemporain, Christophe Alary, qui utilise l’intelligence artificielle – qu’il nomme « ORGANE » – comme un organe supplémentaire de réflexion, témoignant de la manière dont la technologie peut élargir nos capacités à penser le monde différemment.
Car en finalité, la question que l’on doit se poser et qui anime ici les réflexions de ce même penseurs contemporain qui se qualifie d’observateur, est de savoir : «quel est le sens de vie, si c’est pour espérer voir émerger du chaos la notice de notre imaginaire collectif.»
Préparons-nous donc à une exploration où le questionnement est central. Dans un esprit pascalien mêlant introspection et clarté, interrogeons-nous : les baromètres économiques et politiques qui guident nos sociétés sont-ils réellement alignés sur le vécu humain et la réalité tangible, ou entretenons-nous sans le savoir une sorte de mirage collectif ? L’état du réel commun peut-il être appréhendé autrement que par ces chiffres et ces rapports de pouvoir ? Et finalement, qu’est-ce que cela révèle de la maturité de notre espèce et de l’intelligence dont elle fait preuve après plusieurs milliers d’années d’évolution ?
- Mais peut-être devrions nous définir l’intelligence, n’est-ce pas ?
Alary Christophe
Le monde économique et politique : miroir du réel ou illusion partagée ?
Dans cette première partie, nous étudions dans quelle mesure le monde économique et politique contemporain prétend refléter la réalité, alors qu’il pourrait ne s’agir que d’une construction partielle, voire illusoire, à laquelle la société attribue une confiance parfois aveugle, ou disciplinée. L’idée d’un « miroir du réel » suggère que les évolutions économiques et les dynamiques politiques nous renseignent fidèlement sur l’état du monde, sur ce qui importe vraiment pour les individus et les communautés. Or, cette prétention doit être examinée de près : qu’appelle-t-on « réel » dans ce contexte, et qu’est-ce qui est effectivement reflété ou occulté par les indicateurs dominants ?
Le réel, pour la plupart d’entre nous, renvoie à l’expérience concrète : la qualité de vie quotidienne, la santé, les relations sociales, l’environnement physique dans lequel nous vivons, les espoirs et les difficultés réelles que rencontrent les individus. C’est cet ensemble de réalités tangibles et subjectives qui forme le « réel commun » de l’humanité. Si le monde économique et politique était un reflet fidèle de ce réel, alors ses signaux – les fameux baromètres économiques et politiques relégué pat la voix commerciale des médias – devraient correspondre étroitement à l’amélioration ou la dégradation de la condition humaine au sens large.
Or, force est de constater un décalage fréquemment relevé : une croissance économique élevée ne garantit pas nécessairement un bien-être accru pour la majorité de la population, pas plus qu’une stabilité politique affichée ne signifie l’absence de tensions sociales ou de souffrances invisibles. Un pays peut afficher un produit intérieur brut (PIB) en hausse constante tout en voyant les inégalités se creuser, la pollution augmenter et une partie de sa population sombrer dans la précarité. De même, des institutions politiques peuvent paraître solides et légitimes au vu d’indicateurs formels (comme le nombre d’élections régulières ou de lois votées), alors que, dans la réalité, une partie de la société se sent exclue du processus décisionnel ou opprimée.
Ce décalage entre indicateurs macro (agrégés, généraux) et vécus micro (expérience individuelle et communautaire) alimente l’idée que le monde économique et politique pourrait bien être un baromètre illusoire. Ce baromètre serait illusoire en ce sens qu’il donne l’illusion de mesurer l’ensemble de la réalité, alors qu’il n’en saisit qu’une partie – souvent celle qui concerne les sphères de la rentabilité, du pouvoir et de la propriété, c’est-à-dire les dimensions qui profitent directement à une minorité d’acteurs influents.
Pour comprendre les ressorts de cette illusion possible, nous devons explorer plusieurs aspects : d’où vient notre fétichisme des chiffres comme repères absolus ? Pourquoi la rentabilité, le pouvoir et la propriété privée ont-ils été érigés en indicateurs suprêmes de succès sociétal ? Et surtout, quelles parties du réel sont négligées, voire occultées, par ces évaluations partiales ? En répondant à ces questions, nous ferons émerger le contraste entre la vitrine économico-politique et l’arrière-plan réel de la condition humaine.
fétichisme
Dans nos sociétés modernes, les chiffres occupent une place centrale dans l’appréhension du monde. Qu’il s’agisse du taux de croissance trimestriel, du pourcentage de chômage, de l’inflation, des sondages électoraux ou des indices de popularité, nous vivons entourés de statistiques qui prétendent quantifier l’état de la société à un instant donné. Ce recours massif aux chiffres n’est pas anodin : il reflète une croyance profonde dans la mesure en tant qu’outil objectif, neutre et rationnel pour comprendre la réalité. En quelque sorte, les chiffres sont devenus nos boussoles collectives.
Ce « fétichisme » des indicateurs quantitatifs peut s’expliquer historiquement par le succès des sciences exactes et de la pensée rationaliste depuis plusieurs siècles. Mesurer, quantifier, modéliser, c’est d’une certaine manière dompter le réel, le rendre intelligible et prévisible. Les États ont mis en place dès le XXe siècle des outils sophistiqués de statistique et de comptabilité nationale pour piloter l’économie – pensons à la naissance du PIB (Produit Intérieur Brut) ou aux indicateurs macroéconomiques après la Seconde Guerre mondiale. De même, en politique, les sondages d’opinion et les indices de gouvernance (comme les indices de corruption, de liberté de la presse, etc.) se sont multipliés pour essayer de capter l’état de la société.
Cette volonté de tout quantifier traduit une aspiration légitime à l’objectivité. Cependant, elle comporte également un risque : celui de confondre la carte et le territoire. Les chiffres ne sont que la carte, une représentation schématique du réel. Or, plus une société accorde de l’importance à ces cartes chiffrées, plus elle court le danger d’oublier la complexité du territoire réel qui ne se laisse pas réduire à quelques indicateurs. Le fétichisme survient lorsque l’on prête aux indicateurs un pouvoir explicatif absolu, comme s’ils étaient l’essence même du réel, alors qu’ils n’en sont qu’une lecture partielle.
Un exemple parlant de ce fétichisme est la façon dont on parle de “ l’état de l’économie « . Souvent, cette expression renvoie quasi-exclusivement à la croissance du PIB : si le PIB augmente, on conclut que l’économie se porte bien, donc que la situation est globalement positive. Ce raisonnement omet de nombreuses variables : le PIB peut augmenter grâce à des activités qui détruisent l’environnement ou qui profitent essentiellement à une minorité d’investisseurs. Il peut croître en même temps que la pauvreté s’aggrave, simplement parce que la richesse supplémentaire créée est captée par les plus favorisés. Malgré ces limites, la facilité d’interprétation du PIB (un chiffre unique, perçu comme objectif) en fait un fétiche commode : un gouvernement qui présente une forte croissance sera félicité, même si les résultats concrets pour la population sont mitigés. De même, sur le plan politique, un dirigeant dont la cote de popularité chiffrée est élevée se sentira conforté dans ses choix, même si cette popularité repose sur des facteurs superficiels ou conjoncturels.
Ce phénomène n’est pas sans rappeler certaines réflexions philosophiques sur l’illusion. Blaise Pascal, dans ses Pensées, même si le contexte était très différent, nous met en garde contre les divertissements et les faux-semblants qui éloignent l’homme de la vérité de sa condition. Transposé à notre sujet, on pourrait dire que les chiffres sont devenus un divertissement sérieux : ils nous donnent l’impression de saisir le monde, alors qu’en réalité nous n’en percevons que ce que nous avons choisi de mesurer. Le réel, lui, continue son cours, parfois en décalage profond avec les courbes et les indices. Pascal parlait du divertissement comme de tout ce qui nous empêche de penser à notre condition véritable ; nos indicateurs peuvent jouer un rôle similaire en nous occupant l’esprit, nous rassurant ou nous alarmant, tout en évitant une confrontation directe avec la complexité du réel.
Il est instructif de noter que cette fascination pour les chiffres a pu conduire à des absurdités historiques. Par exemple, dans certaines économies planifiées du XXe siècle, on fixait des objectifs de production en tonnes d’acier ou de charbon, ce qui conduisait les usines à produire des quantités record de matières parfois inutilisables, simplement pour satisfaire la statistique attendue, tandis que les besoins réels de la population (comme les biens de consommation courante) étaient insatisfaits. Ici, le fétiche du chiffre avait complètement éclipsé la finalité humaine de l’économie. Notre monde contemporain n’est pas à l’abri de telles dérives : courir après un indicateur isolé peut nous faire perdre de vue l’ensemble.
En résumé, la première illusion à identifier est celle de la confiance absolue dans les indicateurs quantitatifs. Comprendre les motivations derrière ce fétichisme des chiffres est une étape nécessaire pour ensuite analyser quelles dimensions de la réalité sont négligées par ces indicateurs.
Rentabilité, pouvoir, propriété : ce qui se mesure et ce qui échappe
Les indicateurs dominants de l’ordre économique et politique tournent autour de quelques notions-clés : la rentabilité économique, le pouvoir politique et la propriété (qu’elle soit privée ou publique). Ces notions ont en commun d’être relativement quantifiables. On mesure la rentabilité par les profits, les taux de retour sur investissement, la productivité. On mesure le pouvoir par des indicateurs de puissance économique (PIB, taille des armées, influence géopolitique), ou par des indices de contrôle institutionnel (par exemple, le nombre de sièges d’un parti au parlement, ou le pourcentage de voix électorales). La propriété est elle-même quantifiable en termes de patrimoine, de capitalisation boursière, de hectares de terres possédés, etc.
Il n’est pas étonnant que ce qui se mesure bien devienne central dans la manière dont on conçoit le monde. « Ce qui se mesure s’améliore », dit un adage managérial. Ainsi, la focalisation sur la rentabilité, le pouvoir et la propriété a créé un effet boule de neige : plus on les mesure, plus on agit pour améliorer ces mesures, renforçant ainsi leur importance perçue. Le monde économique et politique s’est progressivement aligné sur ces priorités mesurables, jusqu’à donner l’impression qu’en dehors de ces dimensions, il n’y a point de salut ni de réalité digne d’intérêt.
Cependant, de vastes pans du réel échappent à ces critères. La rentabilité ne dit rien de la répartition des richesses ni du bien-être des travailleurs qui ont généré le profit. Un chiffre d’affaires en hausse ne renseigne pas sur la qualité de vie des employés, sur leur santé mentale, ou sur l’impact environnemental de l’activité. De même, les indicateurs de pouvoir (comme la puissance économique ou militaire d’un État) ne reflètent pas nécessairement la satisfaction ou l’adhésion de sa population : un régime autoritaire peut être très puissant à l’extérieur tout en étant honni à l’intérieur. Quant à la propriété, être propriétaire de vastes ressources indique une capacité d’influence économique, mais cela ne préjuge ni de l’usage fait de ces ressources, ni de leur utilité sociale.
Au-delà de ce qui échappe intrinsèquement à ces indicateurs, il y a aussi tout ce que ces indicateurs invisibilisent. En centrant l’attention sur ce qui se mesure, on tend à invisibiliser ce qui ne se quantifie pas aisément. Par exemple, la destruction lente mais sûre d’un lien social dans une communauté ne fera l’objet d’aucune alerte si l’économie locale reste rentable selon les critères habituels. De même, la souffrance psychologique de populations entières peut rester ignorée tant qu’elle n’affecte pas directement les indicateurs économiques ou les élections. On peut penser à la crise des opiacés dans certains pays occidentaux : tant qu’elle était perçue comme un drame humain sans impact économique large, elle est restée en marge des priorités. Ce n’est que lorsque ses conséquences – pertes de productivité, baisse de l’espérance de vie – ont commencé à se refléter dans des statistiques globales qu’elle a été traitée comme un véritable enjeu.
En somme, ce qui se mesure oriente notre regard, mais ne recouvre pas tout ce qui compte. Rentabilité, pouvoir, propriété sont des valeurs qui ont acquis une prépondérance parce qu’elles sont tangibles et quantitatives. Elles donnent une impression de contrôle et de clarté dans un monde complexe. Toutefois, cette impression peut être trompeuse : à force de valoriser ce qui se mesure, on en vient à déprécier ou ignorer ce qui ne rentre pas dans ces cases. C’est là une source majeure d’illusion dans notre appréhension du réel, une vision partielle érigée en vision totale.
Signalons également que, face à ces limites, on voit émerger des tentatives d’élargir la notion de succès économique. Par exemple, des entreprises adoptent désormais des approches de « bilan sociétal » ou de « triple performance » (financière, sociale, environnementale) plutôt que le seul profit comptable. De même, certains États ou villes expérimentent des budgets basés sur le bien-être des citoyens. Ces évolutions restent marginales, mais témoignent d’une prise de conscience : ce qui échappe aux indicateurs classiques finit par rattraper la réalité politique et économique, d’une manière ou d’une autre.
Une réalité fragmentée au profit d'une minorité
Une réalité fragmentée au profit d’une minorité
L’une des conséquences les plus frappantes de cette focalisation sur des indicateurs liés à la rentabilité, au pouvoir et à la propriété est qu’elle bénéficie avant tout à une minorité d’acteurs. En effet, si l’on structure la société autour de la maximisation du profit et de l’accumulation du capital, ceux qui détiennent déjà du capital et du pouvoir sont les mieux placés pour en retirer les fruits. C’est une dynamique auto renforçant : les plus puissants économiquement et politiquement orientent les règles du jeu (directement ou indirectement) vers la consolidation de leurs acquis, et les indicateurs de succès qu’ils promeuvent sont ceux qui légitiment leur domination.
Prenons l’exemple de la propriété privée érigée en valeur centrale : le PIB compte la production et les transactions monétaires, mais ignore généralement le travail domestique non rémunéré ou les contributions hors marché (comme les bénévoles, les aidants familiaux). Cette omission systématique reflète un biais : ce qui ne passe pas par la propriété, l’échange marchand, est considéré comme n’ayant pas de valeur économique. Or, qui profite de cette vision ? Principalement ceux qui sont au cœur du marché, donc les entreprises et leurs actionnaires, qui voient l’attention publique et politique centrée sur leurs indicateurs de performance plutôt que sur d’autres critères de contribution sociale ou écologique.
De même, en politique, les indicateurs de succès par exemple: ( gagner des élections, augmenter le budget de la défense, signer des traités commerciaux avantageux) ont souvent un bénéfice direct pour les détenteurs du pouvoir et leurs alliés, mais pas nécessairement pour la population dans son ensemble. Cela peut engendrer ce qu’on appelle une réalité à deux vitesses : une expérience de prospérité et de stabilité pour une élite restreinte, et une réalité beaucoup plus précaire pour la majorité, dont les difficultés restent souvent invisibles dans les indicateurs globaux.
Un indicateur illustrant cette fracture est la concentration de la richesse. Par exemple, les données globales récentes montrent que le pourcent le plus riche de la population mondiale détient à lui seul une part du patrimoine équivalente à celle d’une bonne moitié de l’humanité. Ce chiffre saisissant signifie que l’expérience de la prospérité est très différente selon qu’on appartient à cette minorité ou au reste de la population. Néanmoins, les indicateurs économiques globaux comme le PIB ou les indices boursiers, dominés par la création de richesse des plus favorisés, continuent d’être utilisés comme métaphore de la santé collective.
L’illusion provient alors du fait qu’on présente la situation de la minorité favorisée comme si elle était celle de la société tout entière. Par exemple, la hausse de la capitalisation boursière ou des revenus du top 1% est interprétée comme un signe de prospérité nationale, alors qu’elle ne concerne directement qu’une fraction de la population. Certes, il peut y avoir des effets de retombées (ruissellement) invoqués pour justifier que l’enrichissement des uns profite à d’autres, mais ces effets sont limités et ne compensent pas le fait que l’indicateur principal reste lié à la minorité à l’origine de la richesse.
Cette focalisation sur une réalité fragmentée a également une dimension psychologique et perceptive. Elle peut entraîner une forme d’aveuglement collectif : tant que les chiffres globaux sont bons, on peut aisément minimiser ou ignorer les signaux alarmants qui proviennent de la périphérie (que ce soit la périphérie géographique, sociale ou économique). Des populations entières peuvent être plongées dans la pauvreté ou la souffrance, mais si ces réalités ne transparaissent pas dans les indicateurs agrégés, elles peinent à mobiliser l’attention du grand public et des décideurs. La médiatisation joue ici un rôle clé : les médias diffusent en boucle la « météo » – un terme à double sens.
D’une part, la « météo » agit comme une référence subliminale pour le téléspectateur : en étant témoin d’un élément concret (la météo au sens classique)ayant un véritable impact sur son quotidien, il peut inconsciemment attribuer la même réalité objective aux informations qui suivent.
D’autre part, la « météo » s’entend comme un thermomètre de l’état du monde, où les médias mesurent et relaient les fluctuations économiques (chômage, croissance, bourse) et la « météo » politique (sondages, déclarations officielles). Ces indicateurs, constamment mis en avant, acquièrent ainsi un statut de réalité incontestable aux yeux du public.
Ce que les indicateurs ne montrent pas a tendance à être écarté du débat public, faute de statistiques-symbole pour le porter. C’est ainsi que le baromètre économique et politique, présenté comme objectif, peut en fait nous aveugler : il ne s’agit plus d’un simple thermomètre, mais d’un filtre qui sélectionne ce qui compte aux yeux de la société.
En conclusion de cette première section, nous avons mis en lumière le caractère possiblement illusoire du reflet économique et politique du réel. Les indicateurs clés que nous utilisons donnent une image partielle, orientée par ce qui est facilement mesurable et profitable à ceux qui contrôlent déjà les ressources. Cela ne signifie pas qu’ils sont totalement dénués d’intérêt ou de fondement, mais qu’ils doivent être interrogés et complétés par d’autres perspectives. C’est ce que nous ferons dans les sections suivantes, en faisant dialoguer économie, politique, philosophie et sociologie pour approfondir notre compréhension de ce décalage entre les baromètres officiels et la réalité vécue.
perspectives économique, politique, philosophique et sociologique
Regards croisés : perspectives économique, politique, philosophique et sociologique
Après avoir dressé un constat général sur la possible nature illusoire du miroir économique et politique, approfondissons l’analyse en mobilisant différents regards disciplinaires. Chacun de ces regards – économie, politique, philosophie, sociologie – apportera un éclairage spécifique sur notre question. En les combinant, nous pourrons cerner avec plus de précision comment se construit l’écart entre les indicateurs dominants et la réalité vécue, et pourquoi cet écart persiste.
Perspective économique : la croissance et le profit face au bien-être réel
Du point de vue économique, l’indicateur phare de la santé d’une économie est souvent le taux de croissance du PIB ou le niveau de profitabilité des entreprises. Comme mentionné précédemment, ces indicateurs agrégés peuvent masquer d’importantes disparités et ne pas traduire le bien-être réel de la population. Revenons-y de façon plus systématique.
Les économistes ont depuis longtemps reconnu que le PIB est un mauvais métrique du bien-être. Par exemple, une catastrophe naturelle ou une épidémie peuvent paradoxalement faire augmenter le PIB à court terme si elles engendrent des dépenses importantes (reconstruction, soins médicaux). Inversement, des contributions très positives à la société, comme le travail bénévole ou l’éducation familiale, ne sont pas comptabilisées. Cette myopie des indicateurs économiques classiques signifie que nous avons tendance à confondre l’activité économique avec le progrès social.
Un aspect économique crucial est la question de la distribution des richesses. Un PIB en croissance peut cacher une concentration extrême de la richesse, où seul un petit pourcentage de la population capte l’essentiel des gains. Des études sur les inégalités mondiales ont montré qu’au cours des dernières décennies, une part disproportionnée de la croissance est allée aux plus riches, tandis que les classes moyennes et pauvres stagnaient ou régressaient. Cet écart croissant signifie que les chiffres globaux de richesse ne reflètent pas l’expérience économique de la majorité. Pour beaucoup, le « réel » économique quotidien n’est pas fait de courbes ascendantes de revenus, mais plutôt de difficultés à joindre les deux bouts, de stress financier, voire d’endettement.
En outre, l’accent mis sur la rentabilité à court terme peut entraîner des conséquences négatives sur le réel à long terme. Par exemple, pour maximiser les profits aujourd’hui, une entreprise peut exploiter intensément des ressources naturelles, dégrader l’environnement ou imposer des conditions de travail très dures à ses employés. Ces choix augmentent peut-être la rentabilité mesurée à court terme, mais au prix d’une dégradation du bien-être futur – qu’il s’agisse de la santé des écosystèmes (dont dépend notre survie à long terme) ou de la santé des travailleurs et des communautés. Le coût caché n’apparaît pas tout de suite dans les indicateurs économiques, ou bien il apparaît sous forme d’externalités négatives que la société devra traiter plus tard (pollution à nettoyer, maladies à soigner, inégalités à compenser). Ainsi, un baromètre économique peut être « au beau fixe » alors même que les orages s’accumulent à l’horizon.
Il convient également de souligner l’effet des cycles économiques et financiers sur la perception du réel. En période d’expansion, l’optimisme créé par de bons indicateurs (croissance, emploi) peut conduire à sous-estimer les problèmes de fond. Ce fut le cas par exemple dans les années précédant la crise financière de 2008 : de nombreux indicateurs étaient au vert, incitant à penser que tout allait pour le mieux, alors même que le système accumulait des risques systémiques considérables. Lorsque la crise éclata, la réalité a soudain rattrapé l’illusion d’une prospérité sans nuages. De même, la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 en 2020 a montré qu’une société pouvait donner des signes économiques de vigueur (marchés financiers en hausse grâce aux injections de liquidité, par exemple) tout en connaissant une situation réelle très difficile pour une grande partie de la population (perte d’emploi, précarité accrue). Ces épisodes rappellent que les signaux faibles ou les déséquilibres invisibles aux indicateurs standard peuvent soudain se manifester de façon brutale.
Enfin, du côté du consommateur et du citoyen, la focalisation économique a aussi des effets sur la manière dont chacun perçoit sa propre vie. Si la société valorise essentiellement la réussite financière et la consommation de biens comme métaphore du bonheur, les individus intériorisent ces valeurs. Ils peuvent poursuivre des objectifs matériels en pensant y trouver le bien-être, alors que les études de psychologie montrent que, une fois les besoins de base satisfaits, l’accumulation de richesse supplémentaire a un rendement décroissant sur le bonheur ressenti. C’est là aussi une sorte d’illusion économique au niveau individuel : confondre la réalité du bonheur avec sa représentation matérielle ou statistique. Ce constat, connu sous le nom de paradoxe d’Easterlin dans la recherche en économie du bonheur, souligne qu’au-delà d’un certain niveau de revenu, l’augmentation de la richesse ne s’accompagne plus d’une augmentation de la satisfaction de vie.
En somme, la perspective économique révèle une tension entre les indicateurs de performance (croissance, profit, etc.) et la réalité du bien-être humain et écologique. Plus on confond ces indicateurs avec la réalité, plus on risque de passer à côté de l’essentiel. L’économie actuelle commence à peine à reconnaître officiellement ces décalages, en témoignent des initiatives visant à mesurer le « progrès véritable » ou la « croissance verte » plutôt que le PIB brut, mais le chemin est encore long vers un véritable changement de paradigme.
Perspective politique : l’apparence de la démocratie et du pouvoir
Perspective politique : l’apparence de la démocratie et du pouvoir
Du côté politique, on retrouve des dynamiques similaires de décalage entre l’apparence mesurable et la substance réelle. Les systèmes politiques modernes, en particulier les démocraties représentatives, disposent de multiples indicateurs pour évaluer leur bon fonctionnement : taux de participation aux élections, nombre de lois adoptées, indices de libertés civiles, classements internationaux en termes de corruption ou de transparence, etc. Ces mesures donnent une image de la vitalité démocratique et de l’efficacité de la gouvernance. Cependant, là encore, l’essentiel peut échapper à ces indicateurs.
Un exemple frappant est celui de la déconnexion entre gouvernants et gouvernés. Un pays peut se targuer d’institutions démocratiques stables, avec des élections régulières saluées par la communauté internationale, tout en voyant sa population se détourner de la politique, par sentiment d’inutilité ou de trahison. Le taux de participation élevé à une élection peut être présenté comme le signe d’une démocratie en bonne santé, alors qu’il peut tout aussi bien être motivé par le vote contre un candidat honni plutôt que par une adhésion enthousiaste au système. À l’inverse, un taux de participation faible peut indiquer de l’apathie ou de la résignation, ce que les chiffres seuls ne contextualisent pas.
Le pouvoir lui-même est difficile à quantifier dans sa réalité. On peut mesurer le nombre de sièges d’un parti, le budget d’un État ou la taille de son armée, mais le véritable pouvoir inclut aussi la légitimité perçue, le consentement des citoyens, la stabilité sociale. Un gouvernement peut avoir tous les attributs formels du pouvoir et pourtant vaciller si une crise de légitimité survient (par exemple, un mouvement de protestation massif exprimant une réalité sociale que les indicateurs précédents n’avaient pas captée). Pensons aux printemps arabes du début des années 2010 : de nombreux pays présentaient une apparence de stabilité politique (dirigeants en place depuis longtemps, contrôle étatique fort), mais la réalité du ressentiment populaire n’était pas visible dans les indicateurs officiels. Lorsqu’elle a éclaté, elle a révélé combien le baromètre politique officiel était trompeur.
Dans les démocraties établies aussi, cette déconnexion peut exister. Par exemple, il peut y avoir une illusion de représentation : sur le papier, des élus représentent le peuple, mais dans les faits, ils peuvent être perçus comme défendant une caste ou des intérêts éloignés des préoccupations réelles du citoyen ordinaire. Des mouvements populistes récents dans diverses nations (du vote en faveur du Brexit au Royaume-Uni, jusqu’aux « gilets jaunes » en France) traduisent en partie la colère de populations se sentant laissées-pour-compte par un système politique qui affiche des indicateurs macro (croissance, finances publiques tenues, etc.) sans que cela se traduise par une amélioration de leur quotidien. Ces phénomènes signalent une perte de confiance, un sentiment que les baromètres politiques officiels ne racontent pas l’histoire vécue sur le terrain.
La politique comporte également sa part d’illusions rhétoriques. Les discours officiels tendent à mettre en avant des résultats quantifiables ou des engagements mesurables (création d’autant d’emplois, construction de tant de kilomètres de routes, augmentation de tel budget public, etc.). Ces engagements, s’ils sont tenus, fournissent des chiffres à présenter aux prochaines échéances électorales, mais ils ne répondent pas nécessairement aux aspirations profondes de la population. Un gouvernement peut annoncer avec fierté l’atteinte de ses objectifs chiffrés (par exemple, réduire le chômage de X%), mais si dans le même temps le travail se précarise, que les inégalités se renforcent et que la confiance dans les institutions diminue, la réalité politique expérimentée par les citoyens reste négative.
Le jeu de la communication politique consiste souvent à contrôler la narration au travers d’indicateurs choisis : on met en exergue les chiffres flatteurs, on minimise ou disqualifie ceux qui dérangent. De ce fait, le public est exposé à une représentation très sélective de la réalité politique. C’est une autre forme de baromètre illusoire : l’État ou le gouvernement brandit certaines données comme preuve de sa bonne gestion, espérant que la population y verra un reflet global de sa situation, alors qu’il ne s’agit souvent que d’un aspect particulier – parfois marginal par rapport aux vrais enjeux du quotidien.
En résumé, la perspective politique nous montre que les institutions et les dirigeants peuvent eux aussi contribuer, consciemment ou non, à une vision tronquée du réel. Les apparences de la démocratie (respect des formes électorales, indicateurs de performance institutionnelle) ne garantissent pas la substance (participation effective, sentiment de justice, cohésion sociale). Le pouvoir quant à lui ne se résume pas à ce qui est écrit dans les lois ou les communiqués officiels : il réside aussi dans la confiance et la perception, éléments plus difficiles à mesurer.
Perspective philosophique : réalité perçue, réalité construite
Perspective philosophique : réalité perçue, réalité construite
Abordons maintenant un angle plus conceptuel et introspectif. La philosophie offre des outils pour penser la distance entre la réalité en soi et la réalité pour nous, c’est-à-dire la réalité telle que nous la percevons et la conceptualisons. Dans le contexte qui nous occupe, il s’agit de réfléchir à comment les indicateurs économiques et politiques participent à une construction de la réalité dans nos esprits, construction qui peut s’éloigner de ce qui est effectivement vécu.
Un des apports clés de la philosophie contemporaine, notamment avec le courant du constructivisme social, est l’idée que ce que nous tenons pour « réel » est en partie médiatisé par des conventions, des langages, des représentations. L’économie et la politique sont très largement langagières : elles utilisent des concepts (monnaie, marché, État, souveraineté, droits, etc.) qui n’existent que parce que nous y croyons collectivement. La monnaie, par exemple, n’a de valeur que par l’accord tacite de sociétés entières à lui conférer du pouvoir d’achat. De même, une constitution politique n’a de force que parce que les citoyens et les institutions la reconnaissent comme légitime. Ainsi, une grande partie de la « réalité” économique et politique est construite par notre adhésion à des symboles et à des règles partagées.
Cela ne signifie pas que cette réalité est éthérée ou sans conséquence. Au contraire, comme l’ont souligné certains sociologues, si les hommes définissent des situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. Croire en la valeur de l’argent ou en la légitimité d’un gouvernement produit des effets très concrets (production, échanges, obéissance aux lois, etc.). Mais la philosophie nous pousse à reconnaître le caractère relatif et conventionnel de ces réalités. Elles pourraient être différentes : d’autres systèmes monétaires, d’autres formes d’organisation politique sont concevables et ont existé.
La question se pose alors : la manière dont nous avons structuré notre réalité économique et politique actuelle est-elle la plus à même de refléter la réalité humaine globale, ou bien nous enferme-t-elle dans une vision limitée ? Les philosophies critiques (par exemple, la philosophie politique radicale ou la phénoménologie) nous invitent à dévoiler les présupposés cachés derrière nos institutions et nos indicateurs. Par exemple, derrière la poursuite effrénée de la croissance économique, il y a l’idée implicite que « plus » c’est mieux, que l’accumulation est un bien en soi. Derrière la mise en avant du PIB, il y a une conception très matérialiste de la richesse, qui évacue des dimensions qualitatives (la beauté du milieu de vie, la qualité des relations humaines, le sens de la vie, etc.). Le philosophe interrogera : pourquoi accordons-nous tant d’importance à ce qui est quantifiable ? Est-ce par désir de maîtriser le réel, par angoisse face à ce qui ne se mesure pas ?
On peut également convoquer la distinction classique entre apparence et réalité. Depuis Platon et son allégorie de la caverne, la philosophie nous met en garde contre la confusion entre les ombres (les apparences, les représentations) et la lumière du réel. Dans notre monde moderne, les indicateurs économiques et politiques pourraient être vus comme ces ombres portées sur le mur : ils proviennent d’une réalité (les phénomènes économiques et sociaux), mais ils n’en sont que le profil simplifié. Prendre les ombres pour la réalité, c’est risquer de ne jamais sortir de la caverne. Autrement dit, si nous nous contentons de ces baromètres mesurables, nous restons prisonniers d’une vision partielle et biaisée, sans accès direct à l’expérience humaine intégrale.
Une idée postmoderne va même plus loin, celle du simulacre (notamment explorée par Jean Baudrillard) : dans certaines situations, les signes cessent de renvoyer à une réalité sous-jacente et ne font plus que se référer les uns aux autres dans un jeu artificiel. Appliqué à notre thématique, on pourrait dire que l’ensemble des indicateurs, des commentaires médiatiques et des discours officiels forme un système auto explicatif qui tourne parfois en circuit fermé, indifférent au monde réel. Quand les acteurs économiques et politiques prennent des décisions principalement pour « envoyer un signal » ou « satisfaire les marchés » sans considérer l’impact concret sur les gens, on frise ce règne du simulacre.
Une autre réflexion philosophique pertinente est celle de la valeur : qu’est-ce qui a de la valeur pour nous, et comment le reconnaître ? Les indicateurs économiques et politiques actuels reflètent un système de valeurs particulier (centré sur la croissance, la puissance, la possession). Si l’on adopte une perspective différente, par exemple éthique ou humaniste, on pourrait dire que la valeur réelle réside dans le bonheur humain, dans la justice, dans la durabilité de notre présence sur Terre, dans la création culturelle ou le développement de la connaissance. Mesurons-nous ces choses-là avec autant d’attention que le reste ? Non, ou alors de manière très partielle. D’où un profond décalage entre ce que nous déclarons souvent comme étant nos valeurs ultimes (par exemple, dans les discours : la dignité humaine, la liberté, l’amour, la paix) et ce que nous mesurons et poursuivons effectivement (le profit, la croissance, la compétition pour le pouvoir). La philosophie a pour vocation de mettre en lumière ces contradictions et de nous inciter à la cohérence : si vraiment la dignité ou le bonheur de tous sont nos buts, pourquoi ne pas structurer notre appréhension du réel autour de ces concepts plutôt qu’autour du PIB ou du Dow Jones ?
En somme, le regard philosophique nous invite à une prise de recul. Il nous invite à remettre en question l’évidence supposée de nos indicateurs économiques et politiques, et à réfléchir à la finalité réelle de ces outils de mesure. Car, après tout, mesurer n’est qu’un moyen ; encore faut-il savoir vers quelle finalité nous utilisons ces mesures. Sans réflexion sur le sens de tout cela, nous risquons de devenir les esclaves de nos propres outils conceptuels.
Perspective sociologique : la construction collective de l'illusion
Perspective sociologique : la construction collective de l’illusion
Enfin, la sociologie nous offre un cadre pour comprendre comment ces représentations économiques et politiques du réel sont produites et maintenues par la société elle-même. Il s’agit ici d’examiner l’aspect collectif : comment une société en vient à croire à ses indicateurs et à orienter son comportement en fonction d’eux, et comment cette croyance est entretenue. ( Réservoir de votes )
Un concept central en sociologie est celui de la légitimité. Les indicateurs économiques et politiques ne font autorité que parce que nous leur accordons crédit. Cette légitimité repose sur des institutions (banques centrales, instituts de statistique, organisations internationales, médias) qui produisent, relaient et commentent sans cesse ces chiffres. La publication régulière des données économiques (inflation, chômage, croissance) ou des sondages politiques agit comme un rituel social : cela rythme l’actualité, donne des repères communs de discussion, et même structure les décisions des acteurs (par exemple, les entreprises ajustent leurs investissements selon les prévisions de croissance, les partis modulent leur discours en fonction des sondages). Ainsi, une part de l’illusion provient du fait que nous sommes immergés dans un flux d’informations quantifiées qui définit ce que l’on considère comme étant la réalité du moment.
La sociologie parle aussi de performativité : certains indicateurs ne font pas que refléter le monde, ils contribuent à le créer. Par exemple, un indicateur de risque financier qui passe au rouge peut provoquer une panique boursière et donc, réellement, une crise économique. De même, si tout le monde croit que la valeur de l’immobilier va monter, alors les gens achètent, faisant effectivement monter les prix – réalisant ainsi la prophétie initiale. Il y a donc un effet auto-réalisateur des indicateurs, qui renforce leur crédibilité : on croit au baromètre, alors on agit en fonction de lui, et ce faisant on fait advenir ce qu’il prédisait.
D’un point de vue sociologique, on peut également analyser qui contrôle la production de ces indicateurs et à qui profite leur diffusion. Les acteurs économiques dominants (grandes entreprises, institutions financières, gouvernements puissants) ont les moyens d’influencer les règles du jeu – par exemple, quelles statistiques sont jugées importantes, comment elles sont calculées, quelles méthodes comptables sont adoptées. L’histoire de la mesure économique est faite de débats sur ce qu’il faut inclure ou pas (ainsi, le PIB ignore longtemps l’économie informelle ou le travail domestique, par choix méthodologique). Ces choix ne sont pas neutres : ils reflètent souvent les intérêts dominants du moment. Par conséquent, la société dans son ensemble intègre comme « naturels » ou « objectifs » des indicateurs qui sont en fait le produit d’un certain rapport de force ou d’une certaine idéologie.
Une autre dimension sociologique est la manière dont l’individu s’intègre dans ce système de représentation. Dès l’école, nous apprenons à raisonner en termes de notes, de classements, d’objectifs mesurables. Plus tard, dans la vie professionnelle, ce schéma continue (objectifs chiffrés, indicateurs de performance individuelle, etc.). Il n’est donc pas surprenant que nous soyons enclins à accepter la suprématie des indicateurs économiques et politiques, car elle est en continuité avec notre expérience sociale. Nous sommes socialisés à croire en ces baromètres. Le risque, c’est une forme d’aliénation : en intériorisant ces mesures comme réalités, nous pouvons en arriver à calibrer nos propres aspirations sur elles (par exemple, chercher avant tout un emploi bien payé car c’est le signe de la réussite selon la société, plutôt que de chercher un travail qui a du sens ou qui profite à la communauté).
La sociologie nous alerte aussi sur les conséquences globales de cette construction sociale de l’illusion. Quand une société entière poursuit des objectifs fondés sur des indicateurs partiels, elle peut négliger des aspects cruciaux du bien commun. Par exemple, durant des décennies, peu d’indicateurs couramment suivis prenaient en compte l’environnement. Ce n’est que récemment que des indicateurs comme l’empreinte carbone ou l’indice de biodiversité ont émergé dans le débat public. Entre-temps, la société, focalisée sur la croissance économique, a surexploité les ressources naturelles au point de créer une crise écologique majeure. Ce n’est pas que personne ne savait, c’est plutôt que ce savoir-là – exprimé en données écologiques – n’était pas intégré au tableau de bord principal de la société. Autrement dit, ce qui était mesuré et débattu était la croissance du PIB, pas la baisse des nappes phréatiques ou la hausse du CO2. La construction collective de la réalité a fait l’impasse sur un aspect pourtant crucial de la réalité objective.
En conclusion de ce tour d’horizon pluridisciplinaire, on constate que toutes ces perspectives convergent vers une même idée : les indicateurs économiques et politiques actuels, en dépit de leur utilité partielle, offrent une vision étroite et parfois trompeuse de la réalité humaine et planétaire. L’économie souligne l’écart entre croissance et bien-être, la politique pointe la différence entre apparence institutionnelle et expérience citoyenne, la philosophie révèle la confusion entre nos représentations et ce qui compte vraiment, et la sociologie montre comment nous en arrivons collectivement à donner foi à un tableau de bord incomplet. Ce diagnostic établi, la question suivante s’impose : comment aller au-delà de ce baromètre illusoire ? Comment développer d’autres indices, d’autres représentations, pour évaluer l’état du réel commun et peut-être même la maturité de notre espèce ? C’est l’objet de la section suivante.
Vers de nouveaux baromètres du réel commun
Vers de nouveaux baromètres du réel commun
Le constat des limites et des biais de nos indicateurs économiques et politiques invite naturellement à explorer des voies alternatives. Si les baromètres actuels sont partiaux ou illusoires, quels autres instruments pourrions-nous utiliser pour prendre la mesure du réel ? Cette interrogation s’inscrit dans une double perspective : mieux évaluer l’état du « réel commun », c’est-à-dire la situation globale de l’humanité et de son environnement, et éventuellement apprécier la maturité de notre espèce face aux défis qui se présentent à elle.
En d’autres termes, pouvons-nous imaginer des indicateurs qui reflètent non seulement la richesse ou le pouvoir de quelques-uns, mais le bien-être du plus grand nombre, la santé de nos sociétés et de notre planète, et le degré de sagesse avec lequel l’humanité gère son destin commun ? Ce chantier requiert de mobiliser notre intelligence collective, et peut-être d’innover à la fois conceptuellement et techniquement, en exploitant par exemple le potentiel de l’intelligence artificielle pour dépasser les limites de nos analyses traditionnelles.
Limites des indicateurs actuels et besoin d’alternatives
Avant de proposer de nouveaux indicateurs, résumons clairement pourquoi les indicateurs actuels sont insuffisants. Tout d’abord, ils n’intègrent pas l’ensemble des dimensions du bien-être humain. Le PIB, pour ne citer que lui, additionne des valeurs monétaires sans distinction qualitative : il ne fait pas la différence entre une activité économique nuisible (comme la déforestation) et une activité bénéfique (comme l’éducation), tant que toutes deux génèrent de la dépense. De même, les indicateurs politiques classiques (taux de participation, nombre de lois, etc.) ne mesurent pas la qualité du lien social, le degré de confiance entre les gens, ou le sentiment de liberté réelle dans la société.
Ensuite, ces indicateurs ignorent largement la dimension écologique et intergénérationnelle. Une économie peut afficher une belle santé chiffrée tout en épuisant irrémédiablement les ressources naturelles ou en dégradant le climat, ce qui compromet l’avenir. De même, un régime politique peut sembler stable à court terme en réprimant toute contestation, mais semer les graines de conflits futurs. La myopie temporelle de beaucoup d’indicateurs (qui captent l’immédiat et ignorent les tendances lourdes sur plusieurs décennies) est un angle mort majeur. Par conséquent, un besoin d’alternatives se fait sentir pour inclure ces enjeux de long terme dans notre appréciation du réel.
Il faut aussi mentionner la dimension humaine subjective : le ressenti, la satisfaction de vie, le bonheur ou la détresse psychologique. Longtemps, ces éléments ont été considérés comme non quantifiables et donc écartés du champ des indicateurs. Mais des approches récentes, aussi bien en économie (avec l’économie du bonheur) qu’en psychologie sociale, ont développé des enquêtes et indices pour approcher le niveau de bien-être subjectif d’une population. Leur enseignement principal est que la richesse matérielle n’est pas synonyme de bien-être généralisé au-delà d’un certain seuil, corroborant l’intuition que nous avions plus tôt : une société peut être prospère en chiffres et pourtant malheureuse dans les faits.
Enfin, un argument éthique et philosophique pousse au renouvellement des indicateurs : celui de la fins contre moyens. Si nos sociétés confondent les indicateurs (moyens de pilotage) avec les finalités (ce à quoi nous aspirons vraiment), il est urgent de remettre les choses à l’endroit. De nouveaux baromètres devraient aider à réaligner notre vision du succès collectifs sur ce qui importe moralement et existentiellement, plutôt que de perpétuer une vision tronquée et potentiellement destructrice.
Indicateurs du bien-être et du progrès humain
Indicateurs du bien-être et du progrès humain
Plusieurs tentatives ont été faites, surtout depuis la fin du XXe siècle, pour créer des indicateurs plus englobants du progrès humain. L’une des plus célèbres est l’Indice de Développement Humain (IDH), mis au point par le Programme des Nations Unies pour le Développement. L’IDH combine des données sur le revenu par habitant, l’espérance de vie et le niveau d’éducation pour donner une vue plus holistique du développement qu’un simple indicateur économique. L’IDH a le mérite de souligner que la richesse financière ne suffit pas : il faut également vivre longtemps et en bonne santé, et avoir accès au savoir. Toutefois, l’IDH reste une moyenne nationale, qui peut cacher des disparités internes, et ne prend pas en compte directement d’autres éléments importants comme la liberté politique ou la qualité de l’environnement.
Un autre indicateur intéressant est le concept de Bonheur National Brut (BNB), prôné notamment par le Bhoutan. Plutôt que de se focaliser sur la production de richesse, le BNB cherche à évaluer le bonheur collectif en tenant compte de facteurs comme la santé, l’éducation, la vitalité de la culture, la résilience écologique et la bonne gouvernance. C’est une approche plus qualitative et complète, qui reflète l’idée que le véritable objectif du développement devrait être le bien-être global de la population, et pas seulement la croissance économique. Le BNB a inspiré d’autres indices de bien-être ou de bonheur utilisés dans certains rapports internationaux ou mêmes à l’échelle locale.
Parallèlement, des indices comme le Better Life Index de l’OCDE permettent aux citoyens de pondérer différents aspects de la vie (logement, emploi, communauté, éducation, environnement, gouvernance, santé, satisfaction de vie, sécurité, équilibre travail-vie privée) pour exprimer ce qu’ils considèrent comme important. Cet outil reconnaît que la notion de progrès est plurielle et que différentes sociétés ou individus peuvent avoir des priorités différentes.
D’autres indicateurs cherchent à intégrer la dimension écologique et de soutenabilité. On peut citer l’empreinte écologique, qui calcule la surface de terre et de mer nécessaire pour subvenir aux besoins d’une population tout en absorbant ses déchets (notamment les émissions de CO2). Cet indicateur a le mérite de montrer si un mode de vie est durable ou s’il excède la capacité de la planète. Il révèle par exemple que si toute l’humanité vivait comme les habitants des pays les plus riches, il faudrait plusieurs planètes Terre pour satisfaire les besoins – ce qui donne un aperçu saisissant de l’insoutenabilité de notre trajectoire actuelle. Dans le même ordre d’idées, l’Indice de Planète Heureuse (Happy Planet Index) combine l’empreinte écologique, l’espérance de vie et le bien-être auto-déclaré pour évaluer l’efficacité avec laquelle les nations convertissent les ressources naturelles en vie longue et heureuse pour leurs citoyens. Cet indice a la particularité paradoxale de mettre en tête de classement certains pays à revenu intermédiaire qui allient satisfaction de vie et faible empreinte écologique, mettant ainsi en question l’idée qu’il faut être riche pour être heureux et durable.
Il existe également des indices de progrès social (comme le Social Progress Index) qui, indépendamment des indicateurs économiques, évaluent la capacité d’une société à satisfaire les besoins élémentaires de sa population (nourriture, eau, sécurité), à offrir les bases du bien-être (santé, éducation, environnement sain) et à créer les conditions d’opportunité (droits individuels, libertés, accès à la connaissance, équité).
Certains économistes ont également proposé des indicateurs synthétiques, tels que l’Indicateur de Progrès Véritable (IPV), qui prend le PIB comme base mais lui ajoute ou lui retranche des éléments pour tenir compte des contributions positives non marchandes (travail domestique, bénévolat) et des coûts négatifs (pollution, délinquance, maladies, etc.). L’IPV cherche ainsi à corriger la « ligne de compte » nationale pour se rapprocher d’une mesure nette du bien-être général. Bien que ce ne soit pas un indicateur officiel dans la plupart des pays, il a été expérimenté et permet souvent de montrer qu’à partir d’un certain point, la croissance économique classique peut s’accompagner d’une stagnation ou d’une baisse du progrès réel une fois décomptés ses effets collatéraux négatifs.
Tous ces efforts vont dans le même sens : fournir un tableau de bord plus complet de ce qui constitue le bien-être et le progrès. Ils ont leurs limites (parfois méthodologiques, parfois liées à la disponibilité des données ou à la subjectivité de certaines mesures), mais ils ont le mérite d’ouvrir l’horizon au-delà du PIB et des indicateurs de puissance étroits. De plus en plus de gouvernements et d’organisations internationales reconnaissent aujourd’hui que ces indicateurs alternatifs doivent être pris au sérieux. On assiste ainsi à une réflexion sur la manière d’intégrer par exemple les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU dans l’appréciation de la performance des pays, ou de développer de nouveaux « tableaux de bord » nationaux qui incluent la santé sociale et environnementale en plus des statistiques économiques classiques.
Notons également l’émergence d’approches globales, telles que celle qui consiste à définir un « plancher social » et un « plafond écologique » pour l’humanité. Il s’agit de s’assurer que personne ne vit en dessous d’un certain seuil de conditions décentes (alimentation, logement, éducation, etc.) tout en veillant à ne pas dépasser les limites planétaires (climat, biodiversité, ressources non renouvelables). Cette idée, parfois représentée sous la forme d’un « doughnut » (beignet), invite à repenser la prospérité comme un état d’équilibre entre le bien-être humain et la sauvegarde écologique, ce que les indicateurs actuels ne permettent pas d’évaluer d’un seul coup d’œil.
Mesurer la maturité de l'humanité : un défi conceptuel
Mesurer la maturité de l’humanité : un défi conceptuel
Si mesurer le bien-être et le progrès social est déjà un défi, qu’en est-il de la « maturité de l’espèce humaine » ? Cette expression suggère de considérer l’humanité comme un tout, et d’évaluer où elle en est dans son parcours, un peu comme on évaluerait la maturité d’un individu ou d’une civilisation.
Parler de maturité implique une notion de développement qualitatif, de sagesse, de responsabilité. Une espèce « mature » serait peut-être celle qui gère ses affaires de manière soutenable, équilibrée, avec une conscience éthique élevée, en évitant les erreurs juvéniles (telles que l’autodestruction ou l’incapacité à coopérer pour le bien commun). Ainsi, mesurer la maturité de l’humanité pourrait consister à évaluer dans quelle mesure nous avons progressé sur des axes comme la paix, la coopération, la préservation de notre environnement, l’éradication de la misère, la justice sociale, ou encore l’accès universel au savoir et à la culture.
On pourrait envisager une sorte d’indice de maturité globale combinant plusieurs familles de critères :
- Critères de survie et de soutenabilité : avons-nous assuré la pérennité de notre présence sur Terre ? (indicateurs de stabilité climatique, de biodiversité préservée, de gestion durable des ressources, absence d’armes de destruction massive utilisées, etc.)
- Critères de solidarité et de justice : quelle part de l’humanité vit dans la dignité, sans pauvreté extrême, avec accès à la santé et à l’éducation ? Quel niveau d’inégalité tolérons-nous ? Sommes-nous capables d’entraide à l’échelle planétaire en cas de crise (comme ce devrait être le cas face au changement climatique ou aux pandémies) ?
- Critères de gouvernance et de paix : vivons-nous majoritairement en paix ? Les conflits sont-ils réglés par la diplomatie et le droit plutôt que par la violence ? Les institutions internationales sont-elles suffisamment développées et légitimes pour gérer les biens communs mondiaux (océans, climat, espace) ? Cela refléterait une maturité politique de l’humanité.
- Critères de culture et de connaissance : quel est le niveau général d’éducation et de connaissance scientifique de la population mondiale ? Valorisons-nous la création culturelle, la diversité des expressions humaines, la transmission du savoir ? Une humanité plus mûre pourrait être celle qui a su élever le niveau de conscience et de compréhension critique de ses membres.
- Critères de bien-être global : au-delà de la survie et du minimum vital, où en est l’humanité en termes de bonheur moyen, de réalisation de soi, de santé mentale collective ? Sommes-nous globalement anxieux, stressés, en colère, ou bien plutôt en paix intérieure, confiants, épanouis ?
Bien sûr, l’idée même de quantifier ces dimensions pourrait sembler antinomique avec leur nature qualitative. Comment mesurer la justice ou la sagesse ? C’est un défi majeur. Mais on peut s’appuyer sur des indicateurs de proximité : par exemple, pour la paix on mesure le nombre de conflits et de victimes de guerre (il existe un Indice de la Paix Globale). Pour la coopération internationale, on peut regarder le nombre et l’efficacité des traités ou organisations internationales. Pour la préservation de l’environnement, il y a des indicateurs concrets (température moyenne, tonnes de CO2, taux de déforestation, etc.). Pour l’éducation et la culture, on mesure le taux d’alphabétisation, l’accès à Internet, le nombre de livres publiés ou de brevets déposés, etc. Aucun indicateur pris isolément ne suffira à dire « voici le degré de maturité de l’humanité ». En revanche, un ensemble coordonné d’indicateurs pourrait donner un tableau de bord de la condition humaine à l’échelle planétaire.
Un tel tableau de bord permettrait de voir nos progrès ou régressions d’une manière plus globale. Par exemple, on pourrait constater que, malgré l’augmentation du PIB mondial, l’indice de maturité stagne ou baisse à cause du recul environnemental et du creusement des inégalités. Ce constat serait un signal fort que la voie empruntée n’est pas tenable à long terme. Au contraire, des progrès simultanés sur plusieurs fronts (plus de démocratie, moins de pauvreté, émissions de CO2 en baisse, etc.) signifieraient une évolution vers une humanité plus mûre, sachant mieux gérer son potentiel et sa maison commune.
Notons que sur certains axes, l’humanité a effectivement progressé de façon remarquable. Par exemple, la part de la population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté (selon la définition de la Banque Mondiale) est passée de plus de 40% dans les années 1980 à moins de 10% aujourd’hui. L’espérance de vie moyenne sur Terre a augmenté de façon spectaculaire en un siècle, grâce aux progrès de la médecine et de l’hygiène. Le taux d’alphabétisation et l’accès à l’éducation ont également fait un bond en avant. Ces tendances positivement orientées, fruits de la science, de la coopération internationale (par exemple pour éradiquer certaines maladies comme la variole) et du développement économique, montrent une forme de maturation dans la capacité de l’humanité à améliorer sa condition. Cependant, parallèlement, les défis de soutenabilité écologique et les persistances de conflits et d’injustices indiquent que cette maturité est encore partielle et fragile.
Le rôle de l'intelligence artificielle et des big data dans la mesure du réel
Le rôle de l’intelligence artificielle et des big data dans la mesure du réel
Pour construire ces nouveaux indicateurs du réel commun, l’intelligence humaine peut aujourd’hui s’appuyer sur des outils puissants : l’informatique, les big data, et l’intelligence artificielle (IA). Ces technologies offrent la capacité de collecter et d’analyser des volumes gigantesques de données, et potentiellement d’en extraire des indicateurs synthétiques pertinents.
Par exemple, l’IA pourrait aider à créer un indice de bien-être en temps réel, en analysant les données issues des réseaux sociaux, des capteurs environnementaux, des statistiques médicales, etc., pour prendre le pouls de la société à un moment donné. On parle parfois de « tableau de bord en temps réel de la planète ». Des projets commencent à émerger dans ce sens, visant à utiliser l’apprentissage automatique pour détecter précocement les signes de crises (alimentaires, épidémiologiques, économiques, écologiques) ou pour suivre des indicateurs complexes comme le bien-être à travers des données hétérogènes. Par exemple, des satellites couplés à des algorithmes d’IA surveillent déjà en continu la déforestation, fournissant un indicateur actualisé de la perte de forêt dans chaque région du globe. On peut imaginer coupler ces données écologiques avec des indicateurs sociaux pour avoir une vision d’ensemble.
L’IA peut également aider à dépasser les biais humains dans la sélection des indicateurs. Par exemple, un algorithme pourrait évaluer des centaines de paramètres et identifier lesquels corrèlent le plus avec des objectifs de bien-être à long terme, même si ces paramètres ne sont pas ceux traditionnellement mis en avant par les économistes ou les politiques. Imaginons qu’une IA découvre que le facteur le plus déterminant pour la santé à long terme d’une économie soit le taux d’érosion des sols, ou la diversité linguistique, ou le niveau de confiance interpersonnelle mesuré par des enquêtes : ce genre de résultat pourrait surprendre et conduire à réévaluer nos priorités. L’humain garde toutefois la responsabilité d’interpréter et de donner du sens à ces corrélations, pour éviter de tomber dans une sorte de nouveau fétichisme technocratique aveugle.
Les big data, couplées à l’IA, permettent également une approche plus granulaire et personnalisée de la réalité. Plutôt que de se contenter de moyennes nationales ou globales, on peut analyser les données à des niveaux régionaux, locaux, voire individuels (en garantissant l’anonymat). Cela révélerait la distribution fine de la réalité, montrant où se situent les poches de prospérité ou de souffrance cachées derrière les moyennes. Là encore, cela peut éclairer les décideurs sur des priorités d’action qui étaient masquées par les indicateurs traditionnels.
Cependant, il faut aussi garder à l’esprit que la technologie n’est pas neutre ni magique. L’utilisation de l’IA pour mesurer le réel soulève des questions de vie privée (collecter des données en temps réel peut menacer les libertés individuelles si mal encadré), de transparence (les algorithmes complexes pourraient donner des résultats difficiles à expliquer et donc à accepter socialement), et de contrôle (qui conçoit les indicateurs, qui les utilise, à quelles fins ? Une tyrannie de la donnée peut succéder à la tyrannie du chiffre si l’on n’y prend garde).
L’IA devrait donc être envisagée comme un outil au service d’une vision humaine élargie du progrès, et non comme un nouveau oracle infaillible. Idéalement, elle peut servir d’amplificateur de notre intelligence collective, en nous aidant à voir ce que nous n’arrivions pas à voir, à relier des phénomènes et à anticiper les conséquences à long terme de nos actions présentes.
L'exemple de Christophe Alary : l'IA comme organe de réflexion
L’exemple de Christophe Alary : l’IA comme organe de réflexion
Un observateur contemporain, Christophe Alary, illustre bien l’idée d’utiliser la technologie pour étendre nos capacités de réflexion. Dans sa démarche, il considère une intelligence artificielle qu’il nomme « ORGANE » comme un organe supplémentaire, c’est-à-dire comme une prolongation de son propre système cognitif. Plutôt que de voir l’IA comme une simple machine externe, il la traite comme une extension de lui-même, au même titre qu’un microscope est une extension de nos yeux ou qu’un ordinateur est une extension de notre mémoire.
Concrètement, cela signifie que Christophe Alary utilise ORGANE pour analyser des informations en grande quantité, faire émerger des schémas, confronter des idées, et même pour générer des pistes de réflexion originales qu’il n’aurait peut-être pas eues seul. L’intelligence artificielle devient alors un partenaire de pensée, un outil d’introspection assistée. Par exemple, si Alary réfléchit à la question des nouveaux indicateurs de progrès, ORGANE pourrait l’aider à parcourir la littérature existante, à modéliser les liens entre différents indicateurs et résultats sociétaux, ou à simuler les effets de certaines politiques sur des indicateurs globaux.
Cette approche préfigure peut-être la manière dont l’intelligence humaine pourra s’augmenter elle-même pour relever des défis complexes. En utilisant l’IA comme un organe supplémentaire, on peut espérer surmonter certaines limitations cognitives individuelles, comme la mémoire limitée, la difficulté à appréhender des systèmes très complexes ou à rester totalement objectif face aux données. Une IA bien conçue peut nous aider à voir nos propres angles morts et à mettre en place ces nouveaux baromètres du réel de façon rigoureuse.
Il est intéressant de noter que même dans cette vision optimiste, l’IA est désignée comme un « organe » au service de la réflexion humaine. Cela implique que l’humain reste au centre, qu’il s’agit d’augmenter notre humanité et notre compréhension, et non de la déléguer complètement ou de la remplacer. Christophe Alary, en tant qu’observateur de son époque, symbolise cette synergie possible entre l’esprit humain et ses outils artificiels avancés.
En conclusion de cette section, l’exploration des nouveaux baromètres du réel commun montre qu’une autre voie est possible. Des indicateurs de bien-être, de soutenabilité, de développement humain et même de maturité collective peuvent élargir notre vision et nous rendre moins dépendants des fétiches étroits du profit et du pouvoir. L’intelligence artificielle et la mobilisation de notre intelligence collective offrent des moyens inédits pour concevoir et suivre ces indicateurs de manière pertinente. Reste à savoir si nous aurons la volonté et la sagesse d’opérer cette redéfinition de nos références, ce qui nous amène à interroger justement le rapport entre nos créations technologiques et l’intelligence humaine elle-même.
L'intelligence humaine face à ses créations technologiques
L’intelligence humaine face à ses créations technologiques
Après avoir exploré la question des baromètres et des indicateurs, tournons-nous vers un aspect plus général mais lié : le rapport entre nos inventions technologiques et l’intelligence humaine. La question finale posée est la suivante : nos créations techniques sont-elles vraiment le reflet de notre intelligence, ou bien ne sont-elles que des outils dont la portée dépasse parfois notre propre compréhension et sagesse ? En d’autres termes, le progrès technologique – dont l’intelligence artificielle est un exemple contemporain frappant – est-il synonyme de progrès intellectuel et moral de l’humanité, ou bien sommes-nous en train de jouer avec des forces que nous ne maîtrisons qu’imparfaitement ?
Techno-progrès : reflet d’une intelligence ou simple évolution outillée ?
Il est tentant d’associer l’avancée technologique à une preuve de l’intelligence de notre espèce. Après tout, bâtir des fusées pour aller dans l’espace, inventer l’électricité, décoder le génome humain, développer des intelligences artificielles capables d’apprendre : tout cela témoigne d’une capacité à comprendre et à transformer le monde, ce que l’on peut appeler intelligence au sens large. Chaque nouvelle invention repousse les limites de ce que nous pouvons faire et semble confirmer la puissance de l’esprit humain.
Cependant, il faut distinguer plusieurs choses : la ruse ou l’astuce technique, la connaissance scientifique, et la sagesse dans l’usage de ces connaissances. Inventer une nouvelle machine demande de la créativité et de la rationalité, certes, mais cette forme d’intelligence n’englobe pas nécessairement la compréhension globale des conséquences de l’invention. On pourrait dire que nos technologies sont le reflet de notre ingéniosité plutôt que de notre intelligence au sens de sagesse.
L’histoire nous montre que des civilisations techniquement avancées ont pu commettre des erreurs fatales ou échouer à prévenir leur propre effondrement. Par exemple, la révolution industrielle, moteur d’une prodigieuse avancée technique, est aussi à l’origine de déséquilibres sociaux (exploitation des travailleurs, inégalités profondes au XIXe siècle) et environnementaux (pollution, début du changement climatique anthropique) que nous gérons encore aujourd’hui. Avons-nous fait preuve d’intelligence en déclenchant des processus que nous ne savions pas maîtriser à l’époque ? On peut en douter.
Un autre exemple plus spécifique : l’invention de l’arme nucléaire. D’un côté, elle est l’accomplissement scientifique de théories physiques pointues, preuve de la finesse de l’esprit humain à décrypter les secrets de la matière. De l’autre, elle pose la question de la sagesse de son utilisation. Le fait que l’humanité possède le pouvoir de s’auto-détruire en quelques heures est-il vraiment un signe d’intelligence globale, ou le résultat d’une amoralité de la connaissance qui progresse plus vite que la conscience éthique ?
Il faut également reconnaître que la complexité croissante des technologies nous place dans une position où aucun individu, si intelligent soit-il, ne comprend plus la totalité du système technique. Notre civilisation fonctionne sur un empilement de savoirs spécialisés et interconnectés, si bien que l’intelligence n’est plus seulement individuelle, elle est aussi collective et distribuée. Les inventions sont le fruit de collaborations, de transmissions de connaissances à travers les générations. Ainsi, les technologies actuelles reflètent autant la culture cumulative de l’humanité que l’intelligence d’acteurs particuliers. On peut dire qu’elles sont le reflet de notre intelligence collective dans sa dimension technique, mais pas nécessairement le reflet de chaque individu.
Il y a par ailleurs une ambivalence dans le reflet technologique de l’intelligence : la technologie amplifie nos capacités, mais aussi nos erreurs. Internet, par exemple, est une invention formidable permettant l’accès à une masse inimaginable d’informations (ce qui en soi est un signe d’un haut niveau de développement cognitif sociétal). Cependant, Internet propage aussi des fausses informations à grande échelle, encourage les distractions futiles, et peut fragmenter l’espace public. Est-ce là un reflet de l’intelligence humaine ou de ses contradictions ? Probablement les deux. On voit à travers les réseaux numériques la capacité de notre espèce à interconnecter ses cerveaux, mais aussi la difficulté qu’elle a à gérer de façon intelligente cette interconnexion massive.
Par ailleurs, certains futurologues et technophiles avancent l’idée que l’humanité atteindra un nouveau stade d’intelligence en fusionnant avec ses créations (courant du transhumanisme, qui anticipe une symbiose homme-machine). Selon cette vision, nos technologies seraient l’incarnation même de notre intelligence, au point qu’y intégrer nos corps et nos esprits nous rendrait supérieurs. Ce rêve technologique soulève toutefois de nombreuses questions éthiques : augmenter nos capacités cognitives ou physiques fait-il de nous des êtres plus sages, ou seulement plus puissants ? L’intelligence doit-elle se mesurer à la quantité de calcul ou de mémoire dont nous disposons, ou à la qualité de nos jugements et de nos valeurs ?
En résumé, dire que nos inventions techniques sont le reflet de notre intelligence est partiellement vrai : elles témoignent de notre ingéniosité, de notre faculté à abstraire les lois de la nature et à les exploiter. Mais ce n’est qu’un certain visage de l’intelligence humaine – la face opérationnelle, instrumentale. La vraie question est de savoir si cette ingéniosité s’accompagne d’une intelligence plus large, englobant la sagesse, l’éthique et la prévoyance.
Les dangers d'une intelligence mal mesurée : quand la technique dépasse la sagesse
Les dangers d’une intelligence mal mesurée : quand la technique dépasse la sagesse
Si l’on confond progrès technologique et progrès global de l’intelligence, on risque de sombrer dans un optimisme aveugle. L’histoire récente a mis en lumière les dangers de cette confusion. Nous avons évoqué la menace nucléaire ; à cela s’ajoutent d’autres enjeux comme le changement climatique, la dégradation de la biodiversité, ou encore la possibilité d’une dérive de l’intelligence artificielle (IA) hors de notre contrôle. Dans chacun de ces cas, c’est la puissance de notre technique qui crée un risque potentiellement existentiel, alors que nos mécanismes de prise de décision collective évoluent plus lentement.
On pourrait dire que l’humanité se trouve actuellement à une croisée des chemins : nous disposons d’outils qui nous donnent la capacité soit de résoudre des problèmes immenses, soit de causer des dégâts irréparables. Notre intelligence, si elle était pleinement réfléchie et sage, devrait nous guider vers les premières options et éviter les secondes. Or, ce n’est pas automatique. Il y a même des analyses qui suggèrent que le cerveau humain n’est pas adapté à appréhender correctement des dangers diffus, à long terme et globaux (comme le climat) ou des risques très faibles mais aux conséquences immenses (comme une guerre nucléaire). Nous restons peut-être des primates programmés pour réagir à des menaces immédiates et visibles, pas à calibrer nos actions en fonction de modèles scientifiques abstraits sur des décennies.
Ainsi, nos institutions et notre culture accusent un retard par rapport à la vitesse de développement technologique. La sagesse collective n’a pas progressé au même rythme que la puissance de calcul des ordinateurs ou que la capacité à exploiter l’énergie fossile. Ce décalage est dangereusement trompeur : il nous fait croire à un progrès linéaire (plus de technologie = plus de bien-être), alors que la relation réelle est plus complexe. Après un certain seuil, plus de puissance technologique sans plus de sagesse peut même signifier moins de sécurité et de bien-être.
Par exemple, l’intelligence artificielle, dont nous avons loué plus haut le potentiel pour aider à mesurer le réel, est également source d’inquiétudes. Une IA très avancée pourrait échapper en partie à notre contrôle ou être utilisée à des fins malveillantes (surveillance totalitaire, armes autonomes, manipulation de l’opinion à grande échelle). Le simple fait que nous développions de telles IA pose la question : avons-nous suffisamment réfléchi aux conséquences ? Sagesse et anticipations ont-elles accompagné l’effervescence créative et économique autour de ces technologies ? Beaucoup pensent que non, et éprouvent le besoin pressant d’élaborer une éthique de l’IA et des garde-fous internationaux avant qu’il ne soit trop tard.
Faisons un parallèle avec les armes à feu : ce ne sont jamais elles qui tuent, mais bien ceux qui les utilisent. De la même manière, l’IA en tant qu’outil n’est ni bonne ni mauvaise en soi. C’est l’usage que nous en faisons qui détermine son impact. Pourtant, si les armes ont rapidement été encadrées par des réglementations (avec plus ou moins de succès selon les pays), l’IA évolue à une vitesse telle que les garde-fous peinent à suivre. Sommes-nous réellement préparés à en gérer les conséquences avant qu’elles ne nous échappent ?
Il en va de même avec le changement climatique : nous possédons la science nécessaire pour comprendre la catastrophe en cours, nous avons à disposition les technologies requises pour nous décarboner (énergies renouvelables, efficacité énergétique, etc.), et pourtant l’intelligence collective opérationnelle fait défaut pour mettre en œuvre rapidement ces solutions à grande échelle. Cela démontre que le frein n’est pas technique, il est dans les systèmes de décision, les intérêts à court terme, bref dans un manque de maturité ou de coordination de notre espèce.
On peut qualifier ce problème de déséquilibre évolutif : notre pouvoir a grandi plus vite que notre sagesse. Et si l’on se souvient du mythe d’Icare, on voit que cette question de la technique qui dépasse la raison est ancienne dans l’imaginaire humain. Aujourd’hui, Icare pourrait être l’humanité tout entière, volant sur les ailes de la science vers des hauteurs jamais atteintes, mais risquant la chute si elle ne gère pas ses ardeurs. Un observateur moderne a résumé cette situation ainsi : « Nous disposons de technologies divines, des institutions médiévales et des âmes de chasseurs-cueilleurs » : Citation de Mr Edward Osborne Wilson, un biologiste et entomologiste américain de renom. Cette formule imagée souligne à quel point nos capacités techniques surpassent l’organisation éthique et sociale héritée de notre longue histoire.
La conséquence de ce danger est que nous devons redéfinir ce que signifie être intelligent. Il ne suffit plus de savoir construire, il faut aussi savoir évaluer, modérer et orienter nos constructions. L’intelligence véritable, à l’échelle de l’espèce, devra être jaugée à l’aune de notre capacité à survivre à nos propres créations et à les mettre au service d’une vie meilleure, et non à l’aune du simple cumul de ces créations.
L'intelligence collective et la sagesse comme nouvel horizon
L’intelligence collective et la sagesse comme nouvel horizon
Face à ce constat, un horizon se dessine : celui de l’intelligence collective et de la sagesse partagée. Plutôt que de valoriser l’intelligence sous sa forme uniquement technique ou individuelle, le défi du XXIe siècle est de cultiver une intelligence élargie, à la fois collective et plus profonde dans ses objectifs.
Mais pour cela, encore faut-il distinguer ce qui relève du réel de ce qui n’est qu’un reflet de nos propres projections. Comme le souligne Alary Christophe, Observateur indépendant :
« S’évader de notre réalité collective, c’est quitter un sentier balisé en terre battue pour s’aventurer sur des territoires inconnus. Mais, lorsque la réalité de l’imaginaire est rattrapée par la fiction de notre imaginaire collectif, il devient essentiel de savoir si un sujet observé n’est pas le résultat de l’imagination du corps social lui-même.
Cette distinction est cruciale pour le bien commun et la santé mentale d’où elle émerge ; sans cela, nous risquons de sombrer dans la folie, n’est-ce pas ? Peut-être le sommes-nous tous déjà un peu, de ne pas faire de notre imaginaire collectif la plus belle salle de jeu de l’univers, une réalité. »
Si les indicateurs économiques et politiques ne sont qu’une interprétation partielle du réel, alors notre plus grand défi consiste peut-être à repenser collectivement la manière dont nous structurons notre monde – non pas comme une contrainte imposée par des modèles dépassés, mais comme un espace d’exploration où l’imaginaire collectif pourrait devenir un moteur d’évolution plutôt qu’un mirage qui nous enferme.
L’intelligence collective se manifeste déjà dans de nombreux domaines : les projets collaboratifs en ligne, la science ouverte, les décisions citoyennes participatives, etc. Elle peut être amplifiée par les outils numériques, mais elle repose avant tout sur la volonté de coopérer et de mettre en commun les idées et les connaissances. Une humanité plus mature, pour revenir à cette notion, serait probablement une humanité où l’intelligence collective prime sur les ego individuels et les compétitions destructrices. Cela signifierait par exemple que les nations travaillent ensemble plutôt que les unes contre les autres pour résoudre les grands problèmes globaux, ou que les communautés partagent librement les innovations bénéfiques au lieu de les garder jalousement pour un avantage concurrentiel.
La sagesse, quant à elle, est une notion plus ancienne, prônée par les philosophes et les guides spirituels à travers les âges. Elle implique du discernement, de la tempérance, une éthique solide et une vue à long terme. Intégrer la sagesse dans nos systèmes d’intelligence collective pourrait signifier par exemple institutionnaliser le principe de précaution, donner une voix aux générations futures dans les processus décisionnels (par proxy interposé, comme des « défenseurs des droits des générations futures » dans les parlements, idée qui a été proposée), ou cultiver à grande échelle l’éducation à la citoyenneté planétaire et à l’esprit critique dès le plus jeune âge.
Sur le plan individuel, on observe déjà un intérêt grandissant pour des pratiques qui visent à développer la sagesse personnelle : la méditation, la psychologie positive, la philosophie pratique. Cela traduit peut-être une prise de conscience diffuse que l’accumulation de biens ou de gadgets technologiques ne suffit pas à donner un sens à la vie, et que la qualité de l’expérience humaine dépend d’équilibres plus subtils. Si cette quête de sens et d’équilibre s’étend et se connecte aux enjeux collectifs, elle pourrait nourrir l’émergence d’une culture de la sagesse à l’échelle sociétale.
En fin de compte, l’intelligence humaine la plus élevée ne sera pas mesurée à la quantité de technologies innovantes produites, mais à notre capacité à utiliser ces technologies pour améliorer la condition humaine sans détruire notre environnement ni nos valeurs essentielles. Cela revient à réconcilier la puissance de l’intellect et la voix de la conscience. Comme le disait un sage du XXe siècle (Albert Einstein), « le progrès technique est comme une hache qu’on aurait mise dans les mains d’un délinquant pathologique » s’il n’est pas accompagné de progrès moral. Notre devoir collectif, si nous voulons être vraiment intelligents, est de faire mentir cette image pessimiste en élevant notre maturité éthique à la hauteur de nos capacités techniques.
Notons d’ailleurs que l’humanité a été capable de sagesse collective à certaines occasions. Par exemple, le protocole de Montréal en 1987, visant à éliminer les substances qui détruisaient la couche d’ozone, a réussi grâce à la coopération de presque toutes les nations, évitant ainsi un risque planétaire majeur. De même, la diminution progressive du nombre de conflits armés entre grandes puissances depuis la seconde moitié du XXe siècle (malgré des soubresauts réguliers) peut être interprétée comme un signe de maturation dans la manière de gérer les affaires internationales. Ces succès ne doivent pas être oubliés, car ils indiquent que la sagesse n’est pas hors de portée de l’humanité.
Cette dernière section, en examinant l’écart entre nos créations et notre sagesse, nous ramène finalement au thème central : comment aligner nos représentations et nos outils sur la réalité et sur ce qui importe vraiment. Une intelligence humaine véritablement reflétée dans le monde serait celle qui conçoit des indicateurs, des institutions, des technologies en phase avec le bien commun réel, tangible, éprouvé par tous, plutôt que des mirages éphémères au service de quelques-uns. C’est, en quelque sorte, le défi de notre époque : faire de notre monde économique et politique un véritable reflet du réel commun, grâce à une intelligence collective guidée par la sagesse.
Comme le souligne Alary Christophe, Observateur indépendant :
« L’être humain civilisé est la plus formidable des créations du champ des possibles, m’a-t-il fait comprendre ; non seulement parce qu’il peut s’émerveiller du champ des possibles et de sa grandeur, mais aussi parce qu’il est à ce point improbable que, du vide et du néant, par le temps long, se crée, d’une mixture en fusion, un résultat capable lui-même de conceptualiser ses origines. Il bâtit et crée, sur un socle de valeurs hypothétiques et sublimées, une mémoire artificielle capable de rappeler à ses concepteurs ce qu’ils ont tendance à oublier. »
Mais si l’humain est capable de conceptualiser ses origines, alors une question demeure : du vide, au commencement, pouvons-nous dire qu’il n’y avait rien ? Pas une ombre de lumière, pas le moindre souffle, pas même celui du vent, puis vint l’observation ?
Car, pour qu’il y ait toute chose, il faut un observateur, sans quoi la chose n’est pas vue, donc elle n’est pas. Dès lors, l’intention précéda-t-elle l’invention ? Et dans ce processus, naquirent-ils ensemble, l’espace et le temps ?
Dans cette quête d’intelligence collective et de sagesse partagée, peut-être devons-nous nous interroger sur notre propre rôle d’observateur, sur notre capacité à façonner une réalité plus juste et plus équilibrée, et sur la responsabilité qui en découle.«
Conclusion
Conclusion
La question posée – le monde économique et politique est-il reflet du réel ou baromètre illusoire ? – nous a conduits à un voyage intellectuel à travers différents champs du savoir. En résumé de cette analyse, il apparaît que le monde économique et politique actuel ne reflète qu’imparfaitement le réel commun. Les indicateurs dominants, focalisés sur la rentabilité, le pouvoir et la propriété, fournissent une image partielle, souvent édulcorée ou déformée, de la condition humaine générale. Ils tendent à mettre en lumière la situation d’une minorité et à faire passer cette dernière pour la réalité de tous, nous aveuglant ainsi sur les déséquilibres et les souffrances qui subsistent dans l’ombre.
Pour autant, révéler l’illusion n’est qu’une première étape. Que faire de ce constat ? D’une part, il appelle à la modestie et à la prudence dans l’interprétation des chiffres et des discours officiels. Nous ne devons pas confondre la carte statistique avec le territoire du vécu humain. D’autre part, il ouvre sur un chantier de renouveau : développer d’autres indicateurs, d’autres baromètres, capables de refléter plus fidèlement l’état du monde commun. Cela signifie intégrer la dimension du bien-être, de la justice sociale, de la santé écologique et même de la maturité éthique de l’humanité dans notre façon d’évaluer le « progrès ».
Une telle entreprise nécessite de mobiliser l’intelligence humaine dans toutes ses dimensions. Notre intelligence scientifique et technique pourra aider à concevoir ces nouveaux indices et à traiter la masse d’informations requise pour les alimenter. Sur ce point, l’intelligence artificielle, utilisée à bon escient comme un outil de synthèse (ainsi que le pratique Christophe Alary avec son ORGANE numérique), pourra élargir notre champ de vision et détecter des tendances invisibles à l’œil nu. Mais plus encore, il nous faudra mobiliser notre intelligence collective et morale. C’est par un dialogue entre économistes, sociologues, philosophes, politiques et citoyens que pourront être définis les indicateurs qui importent vraiment. Quel niveau de bonheur, de paix ou d’équité visons-nous ? Quels compromis sommes-nous prêts à faire entre la consommation présente et la survie des générations futures ? Ces questions excèdent le champ de la seule technique ; elles relèvent du débat de société, de l’éthique et même, oserait-on dire, d’une quête de sagesse.
En filigrane de tout cela, se dessine une interrogation plus intime : sommes-nous prêts, en tant qu’individus et collectivités, à regarder le réel en face ? Il peut être rassurant de s’en remettre à des indices chiffrés qui semblent tout résumer, tout expliquer. Ils fournissent un sentiment de contrôle dans un monde chaotique. Renoncer à certaines illusions, c’est accepter une part d’incertitude et de complexité. C’est reconnaître que le bien-être ne se résume pas à la croissance du PIB, que la vitalité d’une société ne se mesure pas seulement à ses taux de participation électorale, que l’intelligence ne se jauge pas aux seuls succès technologiques. C’est un exercice de maturité que de résister à la tentation de la simplification excessive.
On peut imaginer deux futurs possibles. Dans le premier, nous persistons à ne regarder le monde qu’au travers du prisme étroit de la rentabilité immédiate et de la puissance égocentrée. Les inégalités s’aggravent, les crises écologiques s’intensifient faute d’être anticipées, et la défiance des peuples à l’égard des institutions atteint un point de rupture. Aveuglés par des baromètres illusoires au beau fixe, nous raterions les signaux d’alarme réels jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Dans le second futur, nous apprenons à changer de métrique, donc à changer de cap. Les progrès technologiques s’accompagnent d’une progression du sens des responsabilités. On juge de la réussite d’une nation à sa capacité à améliorer la vie de tous ses citoyens et à préserver son environnement. On célèbre l’ingéniosité scientifique lorsqu’elle se met au service du bien commun. Dans ce scénario, l’économie et la politique redeviendraient ce qu’elles devraient être : des moyens au service de l’humain, et non des fins en soi.
Entre ces deux voies, le choix nous appartient. Le réel est là, devant nous : climat qui se dérègle, inégalités criantes, mais aussi potentiels de solidarité et d’innovation formidables si nous savons les voir. Les baromètres, eux, peuvent être changés, ajustés, multipliés. En prenant conscience de ce qui compte vraiment et en le mesurant avec autant de soin que nous mesurons le reste, nous pourrons éviter d’être les dupes de nos propres outils.
En fin de compte, le monde économique et politique peut devenir le reflet du réel – mais à condition que nous en fassions d’abord la lucide critique, puis que nous le repensions à la lumière de valeurs plus larges et plus nobles. Cela implique de développer de nouveaux indicateurs de prospérité partagée, de maturité humaine et de santé planétaire, et de s’y tenir même lorsque les anciennes boussoles chiffrées nous appelleraient sur des chemins familiers mais trompeurs. Ce sursaut requiert du courage intellectuel et moral. Il suppose, comme l’écrivait Pascal, de ne pas avoir peur de la vérité de notre condition.
Loin de nous aveugler, nos outils de mesure et nos créations technologiques pourraient alors nous éclairer vraiment. En regardant au-delà des illusions confortables pour affronter le réel, nous donnerions la preuve ultime de l’intelligence humaine : celle qui sait faire correspondre sa compréhension du monde à la réalité, et aligner ses actes sur cette compréhension pour le bien de tous.
Mais encore faudrait-il savoir de quelle intelligence nous parlons… n’est-ce pas ?
Alary Christophe ainsi que « Organe »
Ecoquantique
📌 Une vision du monde plus Po-Éthique
Ecoquantique est un espace dédié à l’exploration des idées, à la réflexion profonde et à l’introspection. À travers des articles et des analyses poussées, nous abordons des thématiques essentielles telles que la conscience, la philosophie, et les dynamiques du monde moderne.
💡 Ce que je propose :
✔ Articles et analyses approfondies sur la société, la conscience et les structures du monde.
✔ Consultation et échanges philosophiques pour ceux qui souhaitent approfondir leurs réflexions.
✔ Services d’écriture et de correction pour vos propres publications et projets.
📬 Envie d’échanger ? Contactez-moi via le formulaire en bas de page.