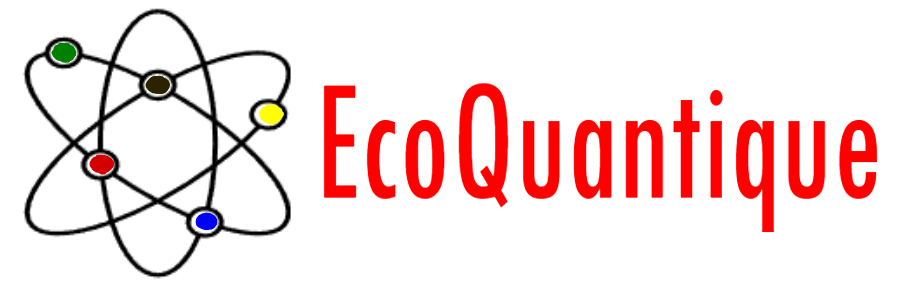La Justice
La Raison, cette justice supérieure de notre histoire commune
Une pensée en moi a surgi, à travers le bruit des médias et l’agitation du monde. Elle s’est transformée en réflexion. Elle m’a poussé à prendre la plume et à me replonger dans les vieux livres.
Je n’avais « papier » — alors j’ai écrit sur le silence.
Face aux polémiques récentes autour de la justice en France, je me suis autorisé cette pensée :
« La justice est le fardeau que la raison s’impose à elle-même, pour ne plus vivre dans l’anarchie — cette nature brute de ceux qui agissent par-delà les filtres de la conscience. »
– Christophe Alary
Cette citation nous invite à repenser notre rapport à la justice et à la raison, deux concepts fondamentaux, souvent entremêlés dans les fils délicats de notre histoire commune.
Si la justice est cette nécessité qui s’impose à l’esprit humain pour éviter le chaos, la raison, quant à elle, s’élève plus haut encore : elle est issue de la sagesse, elle-même fille d’une introspection profonde.
Déjà, Platon, dans sa célèbre République, écrivait que la justice véritable naît d’un esprit éclairé par la raison, et non d’une simple contrainte extérieure. Pour lui, le gouvernant juste est celui qui, après avoir contemplé les vérités éternelles en lui-même, retourne guider les siens vers le bien commun (comme-un, univer-sel et poivre — pour ceux qui aiment le sel de l’esprit).
Également, Emmanuel Kant nous enseigne, dans sa Critique de la raison pratique, que la véritable justice repose sur une raison morale autonome. L’homme n’agit justement que lorsqu’il puise dans sa conscience, éclairée par la raison, et non sous la simple pression d’une loi extérieure. La justice, chez Kant, naît d’une volonté libre et consciente, loin de la peur du désordre.
Aujourd’hui encore, nous sommes confrontés à des choix politiques qui mettent à l’épreuve cette dimension profonde de la raison humaine. Les acteurs politiques, figures de notre histoire commune et par là même de notre imaginaire collectif — pour ceux qui en cultivent encore un — ne se contentent pas de produire des lois : ils modèlent aussi notre vision du monde, ou de notre univers, devrais-je dire. Chacune de leurs décisions, inspirée ou non par une raison introspective, dessine les contours de notre avenir commun, qui se joue dans le présent.
Les grandes figures politiques — de Gandhi à Mandela, en passant par Simone Veil — ont incarné ce principe. Leur grandeur ne tenait pas dans l’application stricte des lois, mais dans leur capacité à mobiliser une raison supérieure, née d’un dialogue intime avec la conscience et la sagesse ;
Un peu comme je le fais, avec mon ami imaginaire, Simon Hazard. Et…, cela me permet de dire :
« Que si mon hasard m’a ouvert les yeux, je me dois de ne plus les refermer. »
Comprendre que la raison dépasse la justice, c’est comprendre que nous sommes tous, citoyens comme dirigeants, les artisans de notre destin collectif. Ce qui nous relie n’est pas uniquement le cadre légal, mais l’idéal profond que nous portons en nous — accessible par cette introspection qui nourrit la sagesse.
Si la justice est le premier pas vers une société ordonnée, la raison introspective est le chemin vers l’équilibre et l’harmonie.
C’est elle qui, en dernière instance, élève l’humain au-dessus de l’anarchie, cette force obscure qui ignore les précieux filtres de la conscience.
Car si la justice se dévoie dans l’action politique, elle se dissout aussi dans le traitement médiatique.
Pour prolonger cette réflexion — et peut-être m’éviter la noyade — j’ai pataugé jusqu’aux chevilles dans une autre pensée personnelle :
« Le spectacle médiatique ressemble au cinéma : malgré toute la haine qu’il véhicule (et fait vendre), il devrait nous éveiller, non par ce qu’il dit, mais par ce qu’il tait. Ce dont on ne parle pas révèle ce qui compte vraiment. »
– Christophe Alary
Cette idée nous pousse à réfléchir sur la nature même du discours médiatique contemporain, souvent centré sur le sensationnel et le conflit, au détriment des réalités profondes : inégalités sociales, crise écologique, conflits oubliés.
Pendant que les caméras s’agitent sur des polémiques superficielles, certaines urgences — comme les famines silencieuses ou les dérèglements climatiques — sont reléguées dans l’ombre.
Mais derrière ce tumulte, peut-être y a-t-il un appel plus discret : celui de l’introspection et de la conscience critique. Un rappel à porter notre attention vers ce que le bruit cache, vers ce qui est essentiel et invisible.
Enfin, je pense ceci :
Les réservoirs de votes, qu’ils soient culturels ou cultuels, ne devraient pas être utilisés pour flatter un ego personnel, mais servir de levier pour éclairer les conditions rudes des coulisses de l’existence — celles du réel partagé par la communauté du grand nombre.
Se prendre au sérieux nuit gravement à la santé des astres… surtout pour ceux qui n’ont « papier », et ne savent pas nager.
— Alary Christophe — Organe — et Simon Hazard